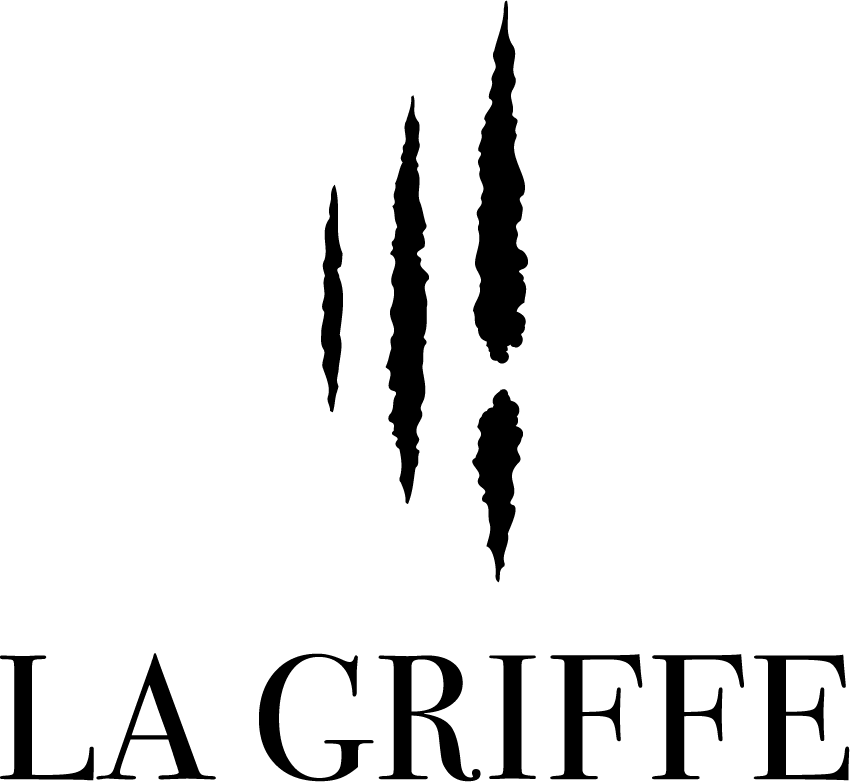LA VOLONTÉ DU BONHEUR, AU-DELÀ DU FREUDISME
Contribution La Griffe Île de France
Rubrique AdHoc
Intérêt général de l’ouvrage ▲▲▲▲▲
Facilité de lecture ▲▲▲▲△
Rapport avec le rite ▲▲▲△△
Freud avait un caractère ombrageux et ses amitiés et séparations avec ses disciples constellent l'histoire de la psychanalyse. Après Adler et Jung, Otto Rank en sera un autre exemple qui prit à rebours la conception du plaisir chez Freud pour la remplacer par le terme philosophique du bonheur, mot totalement étranger à la psychanalyse.
Pour Freud, l'homme est un être de désir parce qu'il est un être de manque. Mais ce désir vers un objet qui souvent se dérobe amène une tension qui est douleur, dès lors le plaisir est la décharge de la tension et non l'objet lui-même qui n'est aimé que comme support de la cessation de la tension. Le bonheur, qui suppose une continuité, n'existe pas du fait du renouvellement constant du désir. Pour Freud, cette tension permanente ira jusqu'à souhaiter Thanatos, l'instinct de mort et un retour symbolique au ventre maternel, là où le désir n'existait pas faute de manques.
Pour Otto Rank, le bonheur est atteignable. Il écrit : « La réussite de la volonté, qui se manifeste dans le vécu, la conscience de cette réussite dans l'événement, tel est le mécanisme du sentiment de plaisir que nous appelons bonheur ».
C'est, en quelque sorte, une jouissance double, dédoublée, dans la réalisation de l'acte volontaire d'abord, et, en même temps, dans le miroir réfléchissant de la conscience qui dit oui une fois encore à cette réalisation.
Autrement dit, la conscience, serait la réalité intériorisée que nous éprouvons douloureusement pendant le temps et dans la mesure où la volonté est incapable de se plier à son service, de la soumettre, comme elle s'efforce de le faire avec la réalité extérieure. En ce sens tout ce qui s'oppose à notre volonté comme un obstacle est réel, qu'il s'agisse de réalité extérieure ou de la réalité intérieure de la conscience. Rank, de façon intéressante, rétablit l'idée d'un libre-arbitre chez l'homme, face à Freud qui conserve l'option très luthérienne de l'homme comme « cerf-arbitre » de ses propres instincts. D'où sa fameuse lettre au pasteur Pfister dans laquelle il dit : « L'éthique m'est étrangère, je n'ai découvert que fort peu de « bien » chez les hommes »
Deux mondes !