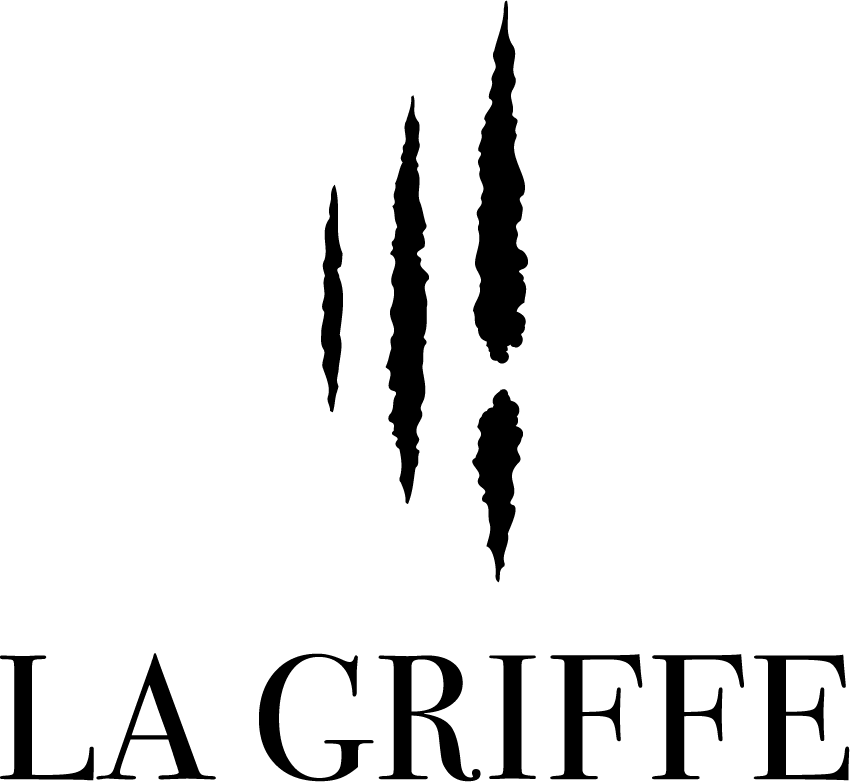L’ÉLOGE DE L’OMBRE
Contribution La Griffe Île-de-France
Rubrique AdHoc
Intérêt général de l’ouvrage ▲▲▲▲▲
Facilité de lecture ▲▲▲▲△
Rapport avec le rite ▲▲▲△△
Roger Sieffert, préfacier de ce livre, en termine ainsi l’introduction : « Éteintes les lampes, place donc au magicien et à son théâtre d’ombre »
Considéré pour beaucoup comme le chef d’œuvre de Tanizaki, ce livre met en exergue la conception japonaise du beau. Dès les premières phrases, ressort un esthétisme narratif, une fluidité subtile et jouissive du style corseté à l’essentiel. Tout cela pourtant, cache en fait, une rivalité historique Orient Occident, sous couvert du traitement de l’ombre et de la lumière et plus profondément encore, l’influence néfaste de l’évolution de l’occident qui aurait anesthésié l’évolution naturelle de la société japonaise, pratiquement dans tous les domaines. La critique acerbe commence dans un endroit inattendu : les lieux d’aisance. « Aussi n’est-il pas impossible de prétendre que c‘est dans la construction des lieux d’aisance que l’architecture japonaise atteint au sommet du raffinement » Alors que l’intention de l’auteur, avouée à la fin de l’opuscule, était d’œuvrer pour un besoin tout à fait différent : « J’aimerais élargir l’auvent de cet édifice qui a nom littérature, en obscurcir les murs, plonger dans l’ombre ce qui est trop visible et en, dépouiller l’intérieur de tout ornement superflu »
Tanizaki éprouve une nostalgie viscérale du passé qu’il va exprimer à travers cette philosophie ancestrale japonaise du traitement de l’ombre dans l’univers humain. Des laques japonaises légèrement poussiérées au maquillage du théâtre No, des flammes de bougies à l’électricité, ce balayage rancuneux nourrit un malaise littéral qui nous fait oublier toute la richesse littéraire du contenu. L’influence de l’innovation occidentale dans les domaines industriels, scientifiques, architecturaux aurait été telle qu’elle aurait stigmatisé l’attachement des japonais aux usages et aux goûts qui les différencient de l’Occident. Tanizaki ironise jusqu’au papier d’Occident dont la surface lumineuse fait rebondir les rayons lumineux alors que le papier blanc de Chine, les absorbe mollement et se plie sans bruit. Pour synthétiser, d’une façon générale : « la vue d’un objet étincelant lui procure un certain malaise ».
Et pourtant ce livre polémique, nous éclaire quant à cette symbolique de l’ombre et de la lumière qui régit chaque démarche de réalisation. Il faut une sensibilité de cherchant, pour considérer que boire la soupe dans un bol de laque, plutôt que dans une assiette blanchâtre, procure une jouissance de nature mystique avec même un petit goût zennique.
Mais paradoxalement c’est là que nous apparaît tout le charme enseignant de ce livre.