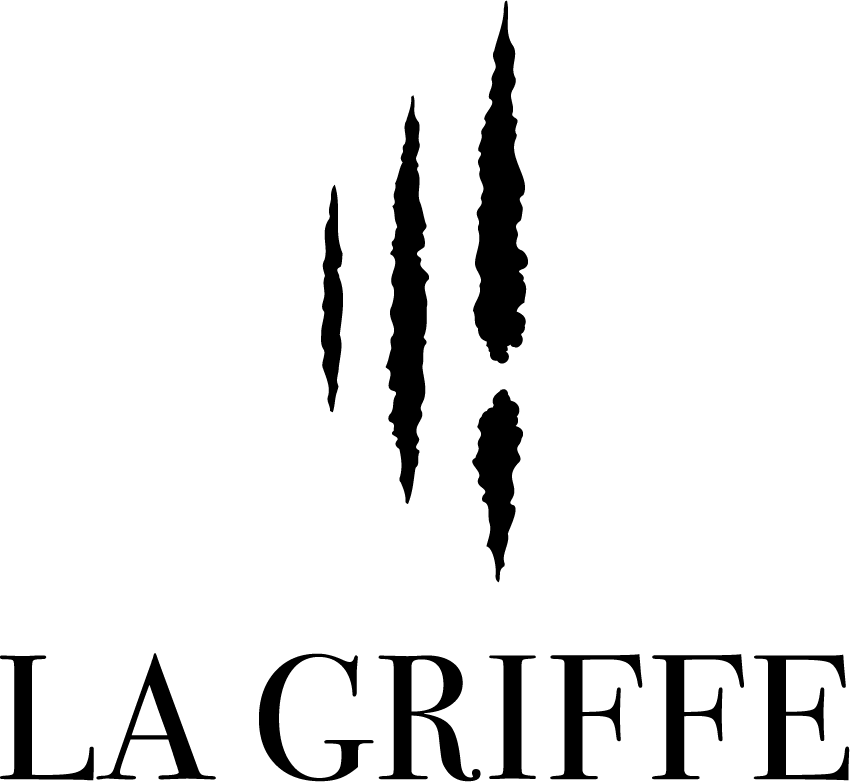HISTOIRE PHILOSOPHIQUE DU GENRE HUMAIN
Contribution La Griffe Languedoc-Roussillon
Rubrique les Incontournables
Intérêt général de l’ouvrage ▲▲▲▲▲
Facilité de lecture ▲▲▲▲▲
Rapport avec le rite ▲▲▲▲△
« L’Histoire Philosophique du Genre Humain » dont la première édition date de 1824 est un monument d’érudition qui nous fait pénétrer dans les profondeurs d’une Histoire de l’humanité à la frontière entre mythes, légendes et réalité historique.
Fabre d’olivet est né à Ganges, une petite ville dans l’Hérault. Il va balayer les conventions historiques ordinaires, réhabiliter la haute antiquité aux limites de la protohistoire. Il va inspirer la relecture des auteurs grecs et latins dans un état d’esprit qui nous les révèlera au-delà également des conventions de l’exégèse littéraire universitaire souvent sans imagination.
Ayant appris l’hébreu, le grec, le latin, l’arabe, Fabre d’Olivet est allé à la rencontre des plus grands auteurs de l’antiquité dans leur langue afin de mieux les comprendre et se rapprocher d’eux.
« L’Histoire Philosophique du Genre Humain » est la synthèse de cet immense travail.
Il remet en question nos convictions sur le sens dans lequel se déroule l’histoire de l’humanité et sur ce que nous pensons être notre condition supérieure comme société moderne.
Cet ouvrage pourrait « déranger » nombre de Francs-Maçons. Aussi laisserai-je la parole à l’auteur lui-même afin qu’il se justifie quelque peu :
« …Nous allons nous entretenir de l’Homme ; et cet être ne nous est encore connu ni dans son origine, c’est-à-dire dans son principe ontologique, ni dans ses facultés, ni dans l’ordre hiérarchique qu’il occupe dans l’Univers… Mon intention n’est pas de répéter ce que l’on trouve partout, mais d’exposer des choses nouvelles et m’élever à des hauteurs peu fréquentées… »
C’est bien à ce but que Fabre d’Olivet a employé sa vie. Mon sentiment personnel, c’est qu’il a réussi. Il a su éveiller assez de curiosité et de perplexité en ses lecteurs pour les ouvrir à une réflexion intemporelle où tous les canons de notre culture judéo-chrétienne deviennent relatifs et s’inscrivent dans des proportions qui permettent des considérations plus universelles et aussi plus naturelles de la place de l’Homme dans la Création.
Si l’ouvrage est épuisé chez les libraires, il reste disponible dans de nombreuses occasions qu’il faudrait savoir saisir !