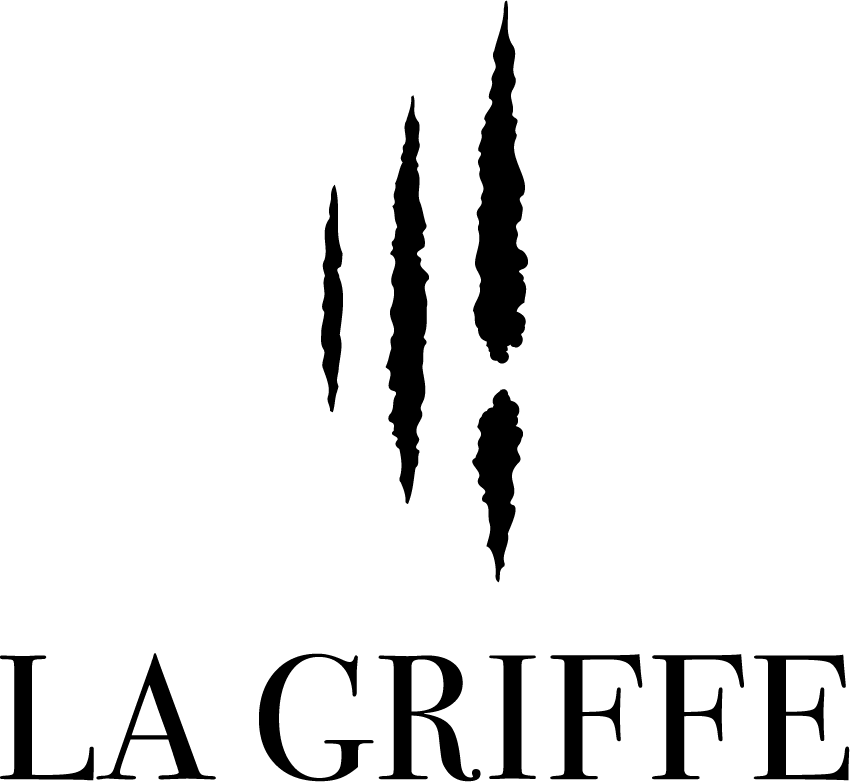L’EXISTENTIALISME EST UN HUMANISME
Contribution La Griffe Midi-Pyrénées
Rubrique Métaphysique
Intérêt général de l’ouvrage ▲▲▲▲△
Facilité de lecture ▲▲▲▲△
Rapport avec le rite ▲▲△△△
Jean-Paul Sartre fait partie de ces auteurs intellectuels, incompris et controversés dont la philosophie est le plus souvent assimilée à un désenchantement, une déshumanisation du monde. Ce que l’on retient, c'est son athéisme, cette absence d'essence qui plonge irrésistiblement l’homme dans le désespoir et l'angoisse.
Mais pour l'auteur, bien au contraire, l'existentialisme est un humanisme rempli d’optimisme qui place l'homme au centre de la lumière et qui fait de lui un être singulier et privilégié.
C'est dans ce contexte qu’il organise en 1945 une conférence sur le thème « l'existentialisme est un humanisme ». Son éditeur de l’époque, sans son autorisation, publie en 1946 un ouvrage qui reprend les grandes lignes développées lors de cette conférence.
C'est ce livre que je vous propose de lire ou de relire.
L'auteur y balaie d'un revers de main les critiques qui lui sont faites. Il clarifie ses pensées, précise ses arguments. Il met en avant la grandeur de l'homme qui peut construire librement son existence, expérimenter les scénarii qu'il a choisi de vivre, qui l'enrichissent et le transforment. Il se distingue des choses ou des animaux qui ne seront que ce que la nature aura décidé pour eux.
J'ai trouvé ses propos construits et sa logique implacable. Elle rend à l'homme sa noblesse, met en avant son potentiel et ses perspectives. Aussi, je considère avec Sartre que l'existentialisme est un humanisme et me refuse à le réduire à un vulgaire concept athéiste empreint de désarroi et de lassitude. L’existentialisme est tout le contraire. Je dirai même que si l’homme est doté d’une essence, cette essence ne saurait être que celle de la liberté, sinon à quoi nous servirait la conscience ?
Cette liberté, nous explique Sartre, nous oblige à passer sans cesse à l’acte et à en assumer les conséquences. La multitude des choix qui s’offrent à nous, à tout instant et en tous lieux, nous plonge dans une espèce de vertige qui nous déstabilise. D’objet nous devenons sujet, de spectateur, acteur. Cette peur n’est pas celle de la mort ou de la finitude, celle décrite par Pascal ou par Heidegger mais elle est celle de l’être responsable qui existe à travers ses choix, à travers les rapports qu’il entretient avec le monde et avec lui-même.
Voilà pourquoi entre le déterminisme religieux, celui de Spinoza et le pessimisme de Schopenhauer, je découvre, là, un chemin possible, intermédiaire et responsable où l’homme peut s’accomplir.