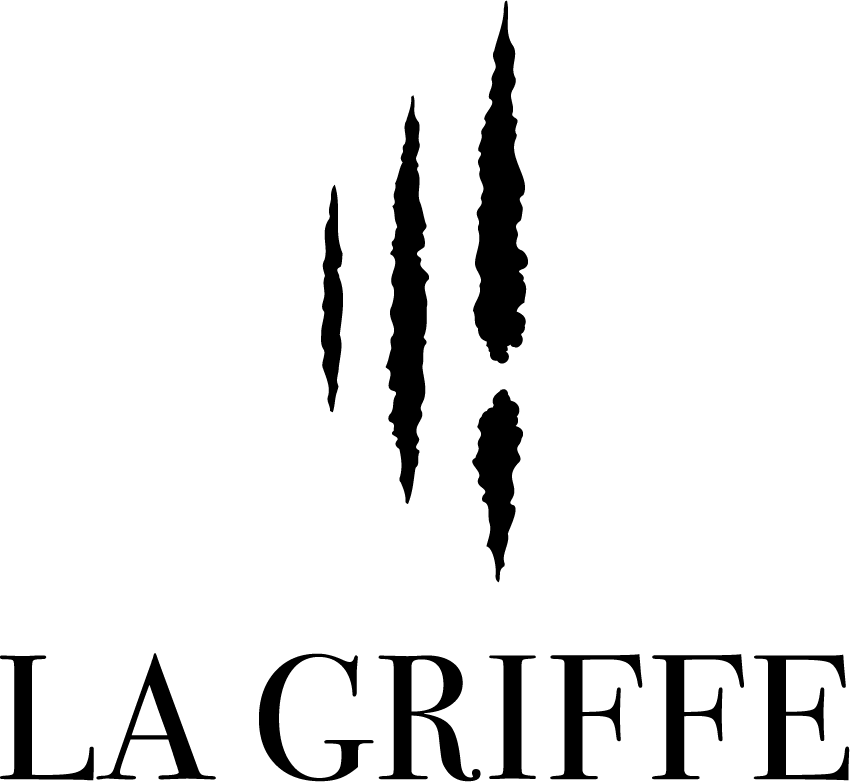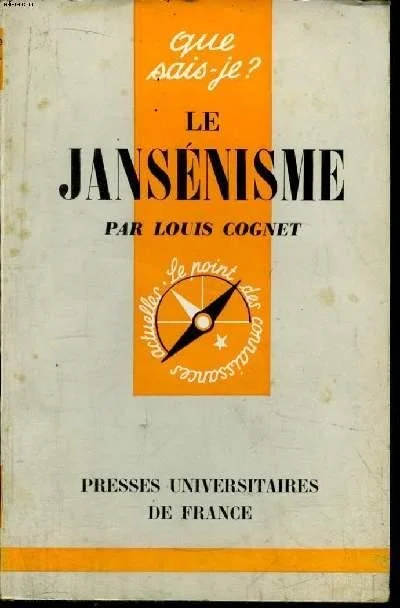Le Jansénisme
Contribution La Griffe Ile de France
Rubrique AdHoc
Intérêt général de l’ouvrage ▲▲▲▲▲
Facilité de lecture ▲▲▲▲△
Rapport avec le rite ▲▲△△△
Incontestablement, Louis XIV ne les aimait pas ! Il ira jusqu'à faire raser le couvent de Port-Royal où avaient pris refuge, autour de la Mère Angélique de Saint-Jean et de Jacqueline Pascal, les sœurs qui refusaient de signer le « Formulaire » qui était l'abandon des thèses de Jansénius et de son soutien en France, Arnault. Toute l'histoire avait débuté par les orientations théologiques du Flamand Corneille Jansen, dit Jansénius, qui s'inspirait de la pensée augustinienne, très en cours au 17e siècle et de l'influence du protestantisme sur la question de la grâce et du libre-arbitre. Ainsi va naître, à l'intérieur de l’Église Catholique, un courant que l'on pourrait qualifier de « néo-protestant » qui va attirer un grand nombre de notables ou d'intellectuels connus qui se sentent plus représentés dans cette orientation et dont les figures de proue en seront, au 17e siècle, Saint-Cyran, Blaise Pascal et Jean Racine. Ils vont trouver sur leur chemin des adversaires redoutables et déterminés : les Jésuites ! Ces derniers, influencés par la pensée de l'un d'entre eux (bien que combattue !), Molina, et de son orientation sur le choix du libre-arbitre et le rejet calviniste de la prédestination. Finalement, le roi sous l'influence de Madame de Maintenon, et l’Église après de longues tergiversations (Par la Bulle « Ugenitus, Dei Filius » du Pape Clément XI, en 1713) condamneront le Jansénisme. Mais ce dernier, loin de disparaître va faire profil bas et constituer le ralliement d'une grande partie de la bourgeoisie, qu'elle soit de robe ou d'affaire. La noblesse et l’Église ne comprennent pas la force et la détermination de cette nouvelle et dynamique classe sociale qui a en main, peu à peu, les représentations parlementaires et le pouvoir financier et qui vont constituer le fameux Tiers-État de la Révolution de 1789, montrant ainsi qu'elle fut une Révolution bourgeoise, en réalité peu influencée par les philosophes, mais sûrement par la continuité de ce courant souterrain. Dans ce sens, nous pourrions dire avec humour : « Merci Saint-Augustin et Jansénius de nous avoir amené le « ça ira » de 1789 » !