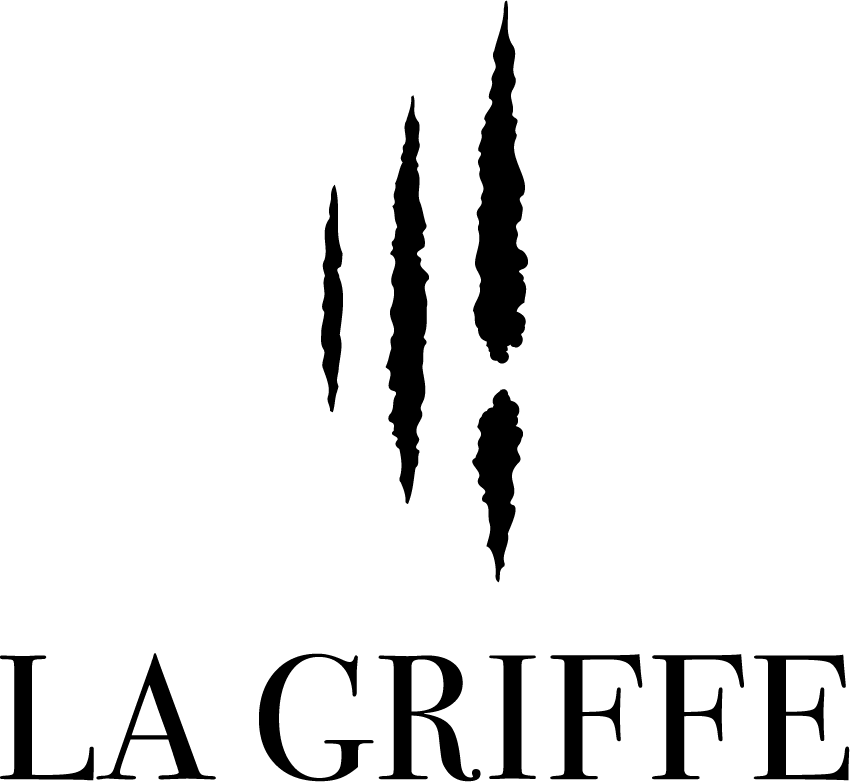LA GRANDE AFFAIRE DE L’HUMANITÉ
Contribution La Griffe Aquitaine
Rubrique Coups de coeur
Intérêt général de l’ouvrage ▲▲▲▲▲
Facilité de lecture ▲▲▲▲△
Rapport avec le rite ▲▲△△△
De la main habile qui façonne les outils, d’homo sapiens au monde digital, l’histoire de l’humanité s’écrit dans une relation privilégiée au travail et à la transmission des savoirs. La longue histoire de la vie sur Terre est décrite en quinze chapitres qui rendent compte de la capacité des lignées des hominidés à capter l’énergie à partir de ses diverses sources, de la géothermie à la lumière solaire, transitant par la fabrication d’outils et la maitrise du feu, creuset de la culture.
La nécessité de travailler émerge des systèmes sociaux « à retour immédiat » des chasseurs-cueilleurs vers ceux « à retour différé » des sociétés agricoles et industrielles et contraint la sédentarité à des accumulations prospectives d’énergie coûteuse en labeurs épuisants. Se mettre à l’abri des risques de pénuries et des dangers environnementaux a engagé l’humanité dans une course aux profits, explicitée par le célèbre adage : « time in money ».
La captation de l’énergie nécessaire à l’entretien des personnes suit de façon exponentielle la croissance démographique, dont le nombre de « bouches à nourrir », selon Malthus. D’où l’explosion démographique depuis l’esclavage jusqu’au travail des enfants, taylorisme qui va ouvrir la voie de l’urbanisation de sapiens tenté par les lumières de la ville, avec en corollaire l’émergence de nouvelles vies professionnelles. La mécanisation et l’industrialisation de la société rendent compte d’une évolution diachronique richement documentée de la nécessité du dur labeur, contraste saisissant avec les révolutions technologiques successives qui engendrent une distorsion de la loi de la juste rétribution de ce même travail.
Ce travail anthropologique riche, documenté, commenté souvent avec humour, en tout cas de lecture enrichissante met en perspective les avancées technologiques avec les effets pernicieux, sinon nocifs de ces dits progrès. « Et même si les salaires réels des ouvriers d’usine augmentèrent lentement au cours de la première moitié du 19ième siècle, la taille moyenne des hommes et des femmes diminua, ainsi que leur espérance de vie ». D’où le « Factory Act » de 1820 interdisant d’employer des enfants de moins de 9ans à temps plein, renforcé en 1833 réduisant les tâches à moins de 12h d’affilé par jour… La prochaine vague d’automatisation viendra-t-elle « lécher les rives des derniers refuges des travailleurs » ?
A quand la disparition du salarié, voire des emplois « inutiles » ?