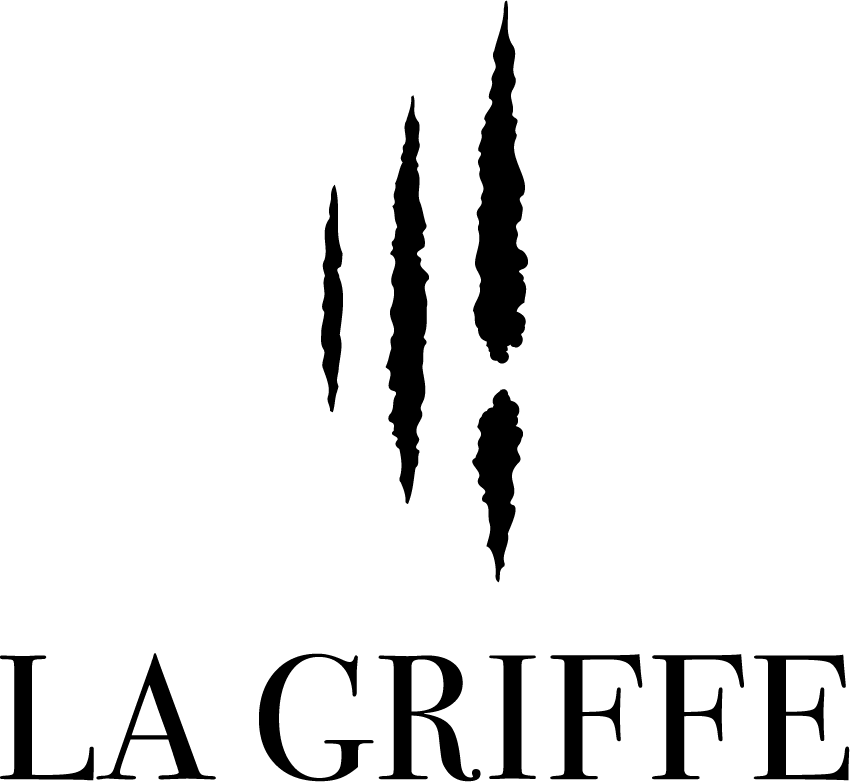MYTHOLOGIES
Contribution La Griffe Lorraine
Rubrique Métaphysique
Intérêt général de l’ouvrage ▲▲▲▲▲
Facilité de lecture ▲▲▲△△
Rapport avec le rite ▲△△△△
Cet essai, écrit entre 1954 et 1956 (les trente glorieuses) comporte deux parties.
La première sous forme d’exemples tirés du quotidien de cette France entrant, alors, dans une culture de masse. La seconde (pages 180 à 233) est une réflexion philosophique appliquée à la notion de mythe aujourd’hui.
La lecture m’en a été difficile, c’est pointu … et passionnant. A mon niveau, j’en ai retenu que « le mythe est une parole, donc un système de communication, un message, ni idée, ni concept, ni objet, mais forme » ou encore « le mythe ne se définit pas par son message mais par la façon dont il le profère » et encore « la mythologie étudie les idées en forme, la sémiologie étant la science des formes (j’ai compris des signes),la recherche du sens inaliénable des choses ». Pour mieux les contrôler ?
Bref, pour simplifier, « l’objet signifie et le mythe le naturalise, changeant un signe en vérité éternelle » (*)
Bon, quittons les bancs du Collège de France où enseigna Barthes et sortons avec lui dans la rue rejoindre la première partie du bouquin.
Là, l’auteur, travaux pratiques obligent, et puisque le mythe remplace l’explication en nous imposant sa force, décortique cinquante trois exemples pris du quotidien qu’il analyse avec intelligence, humour, et sens critique. La DS, L’abbé Pierre, le catch, les martiens, Garbo, le striptease, le music-hall, le steak-frites, etc...
Ce qui va de soi n’est jamais innocent, cachant souvent l’abus idéologique d’une bien-pensance, rassurante évidence, s’adressant et convenant à tous.
D’où, en sous- main, un appel à la vigilance, à la distanciation. (Qu’en bon intellectuel il ne pratique pas toujours). C’est humain.
Que dirait Barthes en 2023, de ce monde saturé et superlatif ? De la téléréalité (hors de toute réalité), des supermarchés (qui n’ont rien à voir avec ceux de la campagne), des postures politiques, de l’art contemporain, des enjeux du sport, des cartes à gratter au bistrot du coin, de la qualité ou de la quantité (le bio), des meubles de cuisine (ouvertes les cuisines) …
Gardons, quant à nous, un regard affuté et conciliateur « du réel et des hommes, de la description et de l’explication, de l’objet et du savoir ». Cette dernière ligne de l’essai est, on ne peut plus, d’actualité.