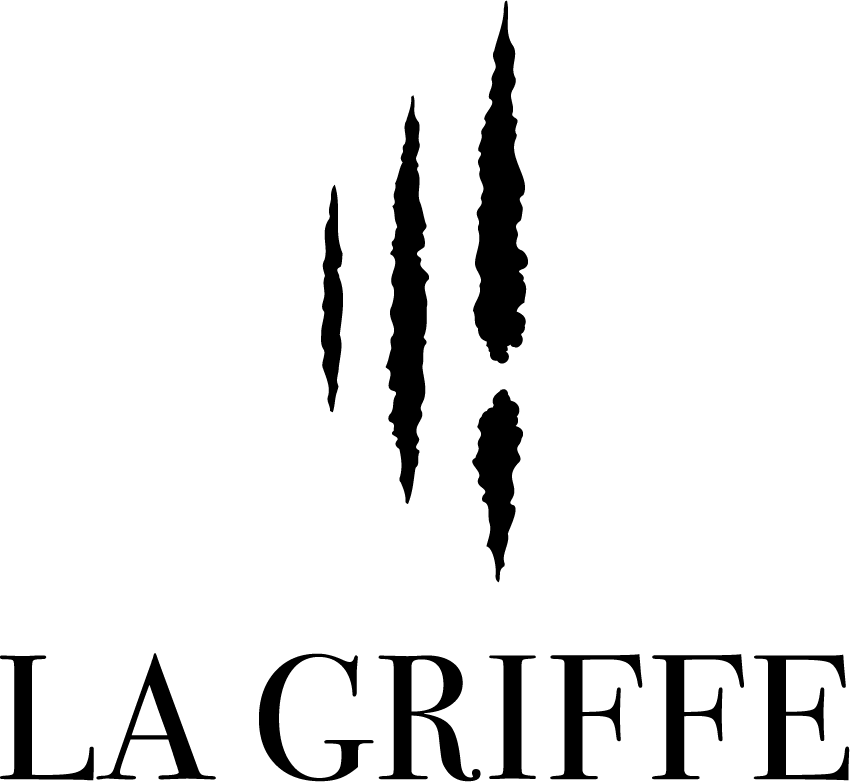SOI-MÊME COMME UN AUTRE
Contribution La Griffe Parisienne
Rubrique Méthaphysique
Intérêt général de l’ouvrage ▲▲▲▲▲
Facilité de lecture ▲▲△△△
Rapport avec le rite ▲▲▲▲△
Raymond Devos aurait pu dire : si mes frères me reconnaissent pour tel c’est parce que moi je suis toi, mais si moi je suis toi, alors tu es moi. Comment ça tuez-moi ! mais enfin, si tu me tues, alors je ne serai plus toi, et alors, que seras-tu ?
Ceci pose la question de la relation entre le je, le moi, le soi, l’autre. Qui est cet autre avec lequel nous dialoguons ? Conscience réflexive disent les psychologues, le soi disent les psychanalystes, notre ange gardien disent les religieux.
Oui je est un autre nous disait déjà Rimbaud et puis Hugo intègre l’Autre : « Ah insensé qui croit que je ne suis pas toi ! ». Hugo ouvre la voix de l’altérité reprise par Levinas ou l’autre est quasiment déifié. Essayons d’y voir clair : la fraternité c’est un lien unissant des êtres qui, sans être frères par le sang, se considèrent comme tels. La fraternité maçonnique englobe une autre notion qui est celle d’égalité : les frères sont sur un pied d’égalité. L’altérité c’est autre chose : pour Levinas c’est la reconnaissance de l’autre dans sa différence culturelle et religieuse ; thème à la mode. L’altérité pourrait se définir comme la fraternité plus l’égalité plus la tolérance plus l’amour. C’est là qu’intervient Paul Ricoeur 1903 2005 qui, sous l’influence d’Emmanuel (pas celui de Pax vobis) mais d’Emmanuel Mounier et de Gabriel Marcel définit l’ipséité. Dans son livre soi-même comme un autre Ricoeur distingue trois intentions philosophiques :
Le primat de la méditation réflexive sur la position immédiate du sujet en opposant le soi à je.
La distinction entre l’identité au sens du idem latin qui le baptise « mêmeté » et l’identité au sens du ipse latin qu’il baptise ipséité. L’une est une notion changeante, l’autre moins. Je suis autre et le même pourtant.
L’ipséité implique une altérité si intime que l’une se ne laisse pas penser sans l’autre. Ricoeur pourfend le cogito de Descartes en disant que le je oscille entre l’exaltation du « je pense » et le rabaissement au rang d’illusion majeure.
Il fut aidé dans les dernières années de sa vie par un jeune homme brillant, qui, à l’époque, se contentait de balayer la chambre des dessins de coller des papiers sur les planches et de délayer l’encre de Chine.